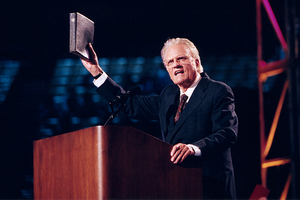 Dans l’Église, la notion même d’autorité n’a pas toujours bonne presse. Les hommes et les femmes qui exercent la prédication dans l’Église sont parfois eux-mêmes gênés par cette idée. Or, quand il est question de l’autorité de la prédication, dans la prédication, et plus encore du prédicateur ou de la prédicatrice(1), les choses se complexifient quelque peu. Déjà en 1971, Fred Craddock, grand homiléticien américain, avait fait fureur en publiant un livre intitulé : As One Without Authority (Comme quelqu’un qui n’a pas d’autorité). Dans cet ouvrage, il argumentait qu’au vu du déclin important de la prédication dans l’Église, il fallait qu’elle se réinvente à moins de disparaître complètement. Sa proposition pour revitaliser l’exercice consista à réorienter le focus sur l’assemblée, ou l’auditoire, plutôt que sur le prédicateur lui-même. Ce faisant, il proposa par exemple que l’assemblée découvre par elle-même le sens du texte biblique plutôt que de le lui expliquer du haut de la chaire (à travers une méthode inductive plutôt que déductive, donc)(2).
Dans l’Église, la notion même d’autorité n’a pas toujours bonne presse. Les hommes et les femmes qui exercent la prédication dans l’Église sont parfois eux-mêmes gênés par cette idée. Or, quand il est question de l’autorité de la prédication, dans la prédication, et plus encore du prédicateur ou de la prédicatrice(1), les choses se complexifient quelque peu. Déjà en 1971, Fred Craddock, grand homiléticien américain, avait fait fureur en publiant un livre intitulé : As One Without Authority (Comme quelqu’un qui n’a pas d’autorité). Dans cet ouvrage, il argumentait qu’au vu du déclin important de la prédication dans l’Église, il fallait qu’elle se réinvente à moins de disparaître complètement. Sa proposition pour revitaliser l’exercice consista à réorienter le focus sur l’assemblée, ou l’auditoire, plutôt que sur le prédicateur lui-même. Ce faisant, il proposa par exemple que l’assemblée découvre par elle-même le sens du texte biblique plutôt que de le lui expliquer du haut de la chaire (à travers une méthode inductive plutôt que déductive, donc)(2).
Bien sûr, le diagnostic de Craddock n’était pas dénué d’intérêt : l’homme moderne exècre la notion d’autorité et a plutôt tendance à ne pas faire confiance à la personne qui se trouve sur l’estrade, derrière la chaire. Mais, si le diagnostic est intéressant, le remède de Craddock doit encore aujourd’hui être questionné. Évidemment, cet ouvrage ne se réduisait pas à cette proposition, mais le cœur de son propos était néanmoins qu’il serait opportun d’abandonner ni plus ni moins l’idée de l’autorité du prédicateur. On sent bien l’ambiguïté et la difficulté de distinguer autorité du prédicateur et autorité de la prédication. Si, pour Craddock, il ne fallait même plus tenter de prêcher avec autorité (d’où le titre de son livre), si le prédicateur lui-même était dénué d’autorité, quelle autorité restait-il à la prédication elle-même ? Faudrait-il aussi abandonner cette notion ? Si non, sur quoi se baserait une telle autorité ? Certains répondront évidemment, et en partie à raison, « sur la Parole ! », mais il convient d’affiner quelque peu le propos et la distinction.
Dans ce qui suit, nous allons donc réfléchir à ces notions : de quelle autorité un prédicateur est-il investi quand il prêche, et à quoi cela peut-il ressembler ?
Quel lien entre « autorité » et « prédication » ?
Il apparaît que, dans les Écritures, et pour le dire probablement de façon lacunaire, s’il n’y a pas d’autorité, il n’y a pas de prédication non plus. Prêcher sans autorité, c’est une contradiction de termes, un oxymore (c’est comme parler de « pluie sèche » ou de « douce violence »).
Quand on examine la façon dont le Nouveau Testament parle de la prédication, les termes associés sont ceux qui évoquent justement l’autorité. À Timothée, son jeune associé envoyé à Éphèse pour y prêcher et pour organiser l’Église, Paul déclare en 2 Tm 3.14-17 :
« Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction ; tu sais de qui tu l'as appris : depuis ta plus tendre enfance, tu connais les Écrits sacrés ; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. » [emphases ajoutées]
À Tite, un autre de ses disciples, il écrit en Tite 2.15 :
« C’est ainsi que tu dois parler, encourager et reprendre, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise ! » [emphases ajoutées]
Certains pourraient s’aventurer sur un terrain dangereux et dire, « Oui, mais ça, c’est Paul : il avait un tempérament autoritaire. Est-ce vraiment le meilleur modèle à suivre ? Ne devrait-on pas plutôt s’inspirer de Jésus ? » (voilà malheureusement des propos que j’ai déjà entendus !). Mais voici comment enseignait Jésus, selon Matthieu 7.28-29 :
« Quand Jésus eut achevé ces paroles, tous restèrent impressionnés par son enseignement ; en effet, il leur donnait son enseignement avec autorité, à la différence de leurs spécialistes des Écritures. » [emphases ajoutées]
Clairement, dans le Nouveau Testament, qui dit prédication/enseignement chrétien, dit aussi autorité. L’un ne va pas sans l’autre. Il faut les maintenir ensemble et nous n’avons pas à nous excuser de ce lien intrinsèque. Ce qui reste à déterminer et à clarifier, en revanche, c’est ce que cette autorité signifie et ce à quoi elle ressemble.
D’où l’autorité ne vient pas
Pour comprendre ce qu’est l’autorité du prédicateur, il est important de mentionner quelques malentendus.
Premièrement, l’autorité ne vient pas de l’expérience du prédicateur (le fait d’avoir « de la bouteille »). Des Églises attendent souvent des pasteurs expérimentés parce que cela leur donne plus de poids, plus de sagesse et donc, plus d’autorité. On veut par exemple qu’ils aient eu une expérience professionnelle avant d’être entrés dans le pastorat, pour qu’ils puissent comprendre le monde du travail et accompagner les gens. On veut qu’ils soient mariés et qu’ils aient des enfants, pour pouvoir en parler en connaissance de cause et accompagner au mieux les familles, etc. Bref, on veut des pasteurs qui ont vécu car c’est cela qui serait constitutif de l’autorité. Pour avoir et pour parler avec autorité, il faut connaître la vie.
Malheureusement, cette intuition, ou idée reçue, ne tient pas totalement, car elle ne peut tout simplement pas s’appliquer à tous les sujets. Au risque de pencher dangereusement vers l’absurde, on ne peut pas demander à son pasteur d’être un meurtrier pour pouvoir prêcher sur les textes qui parlent de meurtre. On ne peut pas non plus lui demander d’être divorcé pour pouvoir accompagner les personnes qui connaissent de telles ruptures. Et ainsi de suite… Clairement, considérer « le vécu » ou « l’expérience » comme base d’autorité est un socle trop peu stable (même si, évidemment, l’expérience et le vécu peuvent être utilisés à bon escient). L’expérience n’est pas constitutive de l’autorité du prédicateur.
D’autres domaines connexes sont évidemment concernés comme ne pouvant être ce sur quoi repose l’autorité du prédicateur : elle ne vient pas de son éducation, de sa formation théologique (même si celle-ci est évidemment importante et qu’il faut la valoriser et l’encourager !) ; elle ne vient pas de son aspect extérieur (ses beaux habits, sa robe pastorale…) ; elle ne vient pas de son compte en banque ; elle ne vient pas de sa capacité à bien parler ou du ton de sa voix (doux ou colérique) ; elle ne vient pas de son âge, de sa confiance en soi, de ses qualités, de ses compétences ; etc. Rien de tout cela – quand bien même certaines qualités et compétences sont excellentes – n’est constitutif de l’autorité que le prédicateur va exercer dans sa prédication.
En fait, le point commun entre tous ces exemples est que l’autorité du prédicateur ne vient pas du prédicateur lui-même. D’ailleurs, s’il est vrai qu’avec de la compétence, une bonne formation et un peu de bagou, on peut certainement réussir à tromper les gens pendant quelque temps, cela ne peut pas durer très longtemps. De toute façon, ce n’est pas satisfaisant… Non, l’autorité du prédicateur lui est forcément déléguée. Elle ne vient pas de lui, elle lui est donnée.
Un récit des Actes des Apôtres met particulièrement bien en lumière cette réalité :
« Pierre et Jean montaient au temple à l’heure de la prière (la neuvième heure). Or on portait un homme infirme de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit : Regarde-nous. Lui les observait, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. Mais Pierre dit : Je ne possède ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : par le nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche ! Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l’instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes ; d’un bond il fut debout et il se mit à marcher. » (Ac 3.1-8)
Pierre et Jean avaient bien compris que c’était le Christ qui agissait à travers eux, et qu’en eux-mêmes, ils n’avaient rien à offrir, aucun pouvoir et aucune autorité. Ils étaient de simples conduits…
Une autorité déléguée
Le mot grec pour autorité est exousia. Il signifie « autorité, juridiction, pouvoir, droit et force ». Ainsi, l’exousia est assez proche de l’idée de pouvoir. Pourtant, le grec distingue ces notions. Au risque de simplifier, on peut dire que l’autorité (exousia) est le droit d’utiliser le pouvoir (dynamis). C’est la capacité qui est offerte d’accomplir un acte.
Ainsi, en Luc 9.1, par exemple, Jésus « appela les douze et leur donna puissance (dynamis) et autorité (exousia) sur tous les démons, et pour guérir les maladies ». Ici, on pourrait penser que les deux sont synonymes, mais il est bien plus probable que l’autorité accordée par Jésus à ses disciples concerne en fait le droit et la capacité d’utiliser la puissance de Dieu pour chasser des démons et guérir des malades.
Ainsi, l’autorité ne peut qu’être reçue afin d’être exercée. C’est pour cela que les grands-prêtres ont demandé à Jésus par quelle autorité il enseignait : « Qui t’a donné cette autorité ? » (Matt 21.23, emphase ajoutée). Ils savaient que l’autorité n’est pas quelque chose que l’on s’attribue soi-même.
Sur la base de cette distinction des termes « autorité » et « puissance », on peut remarquer qu’il est tout à fait possible d’avoir du pouvoir sans autorité, et vice-versa (j’ai du pouvoir, mais je n’ai pas le droit de l’exercer, par exemple – un peu comme dans le dessin animé Les indestructibles, où les super-héros ont interdiction d’utiliser leur super-pouvoirs). On peut aussi usurper l’autorité et l’utiliser à mauvais escient (en usant de violence par exemple – comme quand on prend le pouvoir de force). Et enfin, on peut avoir reçu l’autorité, mais ne pas l’exercer, ou ne pas l’exercer correctement (soit en étant autoritaire, soit en faisant preuve de crainte, ou de fausse modestie, toutes attitudes qui handicapent et immobilisent).
Ainsi, prêcher avec autorité, c’est avoir reçu le droit et la capacité d’utiliser un pouvoir, une puissance. L’autorité du prédicateur est une autorité déléguée. Mais par qui ? D’où vient cette autorité déléguée ? La réponse qui est la plus fréquemment donnée, à juste titre, est de dire que l’autorité du prédicateur lui vient des Écritures, de la Parole de Dieu révélée. C’est évidemment juste. La Bible, en tant que Parole de Dieu, a été investie de l’autorité de Dieu lui-même, et elle fait autorité sur le prédicateur. Puisqu’elle est Parole de Dieu, le prédicateur doit la recevoir pour lui-même, et ensuite la transmettre, l’enseigner, la proclamer. Ainsi, on prêche avec autorité quand on prêche la Parole de Dieu fidèlement. L’autorité du prédicateur repose sur la Parole de Dieu. Il est investi d’autorité parce que la Parole sous laquelle il se place est elle-même source d’autorité.
Affirmer cela conduit à plusieurs conséquences pratiques essentielles. Par exemple, si la Bible est Parole de Dieu, si elle fait autorité, si le prédicateur est censé l’enseigner fidèlement dans la prédication, cela requiert de sa part une attention toute particulière à cette Parole : qu’il l’étudie en profondeur, la médite, la sonde. Bref, qu’il y passe du temps, ainsi que dans des commentaires bibliques, par exemple. Si elle est Parole de Dieu, et si le prédicateur est appelé à l’enseigner, il ne peut ni ne doit se contenter d’une lecture et d’une étude superficielles. Il est, pour reprendre les propos de Paul en 1 Corinthiens 4.1, un « intendant des mystères de Dieu ».
Il serait possible de s’arrêter là. Prêcher avec autorité, c’est prêcher fidèlement la Parole de Dieu (ou : l’autorité du prédicateur est celle que la Parole de Dieu lui délègue). Pourtant, il est essentiel de se souvenir que l’autorité des chrétiens ou des prédicateurs de la Parole (et, au final, toute autorité déléguée) trouve ultimement sa source en Dieu ! En effet, Dieu est l’autorité ultime. Sans relativiser ou encore moins nier l’autorité de la Parole de Dieu, il faut se souvenir que la Parole n’est pas Dieu. Elle a reçu autorité justement en ce qu’elle est Parole de Dieu, qu’elle émane de Dieu qui l’inspire). Dieu est donc l’autorité ultime. Ceci est évident dans les Écritures : Dieu est créateur (il parle et la chose arrive) ; il appelle (par exemple Abraham et Abraham quitte son pays). Dieu exerce aussi son autorité par des événements extraordinaires, des miracles… Dans le Nouveau Testament, son Fils, Jésus, est investi parfaitement de cette autorité divine. C’est ainsi qu’il déclare : « toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre » (Mt 28.18). Dans l’évangile selon Matthieu, Jésus a d’ailleurs vraiment autorité sur tout : dans son enseignement, sur les éléments comme la mer et le vent, sur les démons et les maladies… Bref, toute l’autorité (de Dieu) est sienne.
Mais dans les évangiles, on remarque – et c’est peut-être une surprise – que les disciples reçoivent également l’autorité (déléguée) de Jésus, avant même sa résurrection et son ascension vers le Père. Ils sont envoyés, mandatés par Jésus lui-même, avec son autorité, pour continuer son œuvre, pour faire avancer son royaume en paroles et en actes (cf. Mt 10.1-16 ; Lc 9.1 ; Lc 10.17-19, etc.).
Et plus tard, dans les Actes et dans les épîtres, toute l’Église et tous les chrétiens reçoivent l’autorité pour œuvrer dans le monde de Dieu. Les chrétiens sont tous des agents accrédités par Dieu lui-même. Ils sont eux-mêmes des dons qui sont faits à l’Église, et ils sont en cela investis d’une autorité divine. Ils mettent en œuvre les dons spirituels qui leur sont donnés avec autorité – une autorité déléguée par Dieu lui-même(3).
Il est dès lors possible – et souhaitable – de faire du lien avec les prédicateurs de l’Évangile et d’affirmer que, selon la Bible, ils sont bien investis de l’autorité de Dieu (directement). Leur autorité n’est pas seulement basée sur la Parole qu’ils prêchent, même si c’est cela aussi. L’autorité des prédicateurs vient directement de Dieu, qui appelle et équipe des hommes et des femmes pour ce ministère de proclamation de sa Parole. Il va sans dire (quoique !) que cet appel intérieur à prêcher la Parole doit être reconnu par l’Église qui, elle aussi, dans son discernement, accrédite d’une certaine façon cet appel divin et donne autorité au prédicateur pour l’exercice de son ministère. L’autorité doit donc être assumée par le prédicateur et reconnue par l’assemblée, mais elle ne doit ni être revendiquée par le prédicateur ni imposée à l’assemblée(4). Il n’en demeure pas moins que l’autorité des prédicateurs est une autorité divine, dans le sens précis exposé ci-dessus. Ainsi, dans les deux cas, l’autorité de la Parole et l’autorité de Dieu lui-même, on peut dire que Dieu s’adresse à l’assemblée à travers le prédicateur appelé.
Évidemment, cela peut provoquer quelques vertiges ! Le privilège donné est aussi une immense responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Rien de tout cela ne peut être pris à la légère, au risque pour les prédicateurs de tomber dans toutes sortes d’abus qu’une mauvaise compréhension de l’autorité pourrait induire : les exemples de prédicateurs peu soucieux de leur position ont malheureusement été nombreux à travers l’histoire. L’autorité donnée/déléguée peut « monter à la tête » et rendre orgueilleux. Pourtant, une telle autorité n’autorise en rien l’autoritarisme, ni la liberté de faire passer des messages qui ne trouvent pas leur source dans la Parole de Dieu. Bien comprise, l’autorité est pour l’épanouissement du peuple de Dieu, pour promouvoir la vie. C’est une autorité pour servir, et non pour se servir(5). Elle ne doit donc jamais servir à « faire mousser » celui qui l’a reçue, tout comme elle ne peut jamais être utilisée pour diriger ou manipuler les gens comme des petits pions sur un échiquier…
Comment s’exprime l’autorité dans la prédication ?
Justement : à quoi doit ressembler cette autorité que Dieu confère aux prédicateurs ? Comment peut-elle ou doit-elle s’exprimer, concrètement ? Pour répondre à ces questions, il est essentiel de partir des attributs de Dieu lui-même : Dieu est amour, sagesse, patience, bonté, tout-puissant, etc., et son autorité consiste à l’exercice souverain de tous ses attributs. Avec tout ce qu’il est, Dieu est en train de « refaire » le monde, de le « remettre à l’endroit », de le guérir, de le transformer et de le sauver (« il promeut la vie », donc). Comme nous l’avons vu, pour ce faire, il se sert, entre autres, de prédicateurs qui doivent, sous son autorité et celle des Écritures, participer à l’œuvre de salut de Dieu dans le monde. Investis qu’ils sont de l’autorité de Dieu, ils ne sont pas invités à faire du mal aux gens, à les opprimer, à les presser comme des citrons ou à leur crier dessus. Ils doivent être imitateurs de l’autorité de Dieu lui-même, qui s’exerce par ses attributs. C’est ainsi qu’ils sont appelés à participer à l’exercice de l’autorité de Dieu dans le monde.
Concrètement, j’aimerais mettre en avant, de façon non exhaustive, plusieurs caractéristiques positives que l’autorité du prédicateur pourrait refléter et à travers lesquelles elle pourrait s’exprimer.
1. Clairement, si son autorité ne vient pas de là, on peut dire qu’elle est, d’une certaine façon, augmentée ou rendue possible par une vie intègre. Non l’autorité, mais la crédibilité du prédicateur est ici en jeu. Paul, en 1 Timothée 3.1–7, offre une liste de qualifications pour le ministère d’ancien dans l’Église, et parmi celles-ci se trouvent non seulement la capacité d’enseigner, mais aussi le fait d’être « irréprochable »… Cela semble bien évidemment inatteignable (qui peut se targuer d’être irréprochable ?), mais le fait est que Paul n’avait de cesse de renvoyer à sa vie et à son caractère pour démontrer qu’il était un apôtre crédible, pour démontrer que son ministère était légitime. C’est aussi cela qui donnait du poids à son message. Or, ce que Paul visait dans sa propre vie, il l’envisageait aussi pour ses disciples. Cela apparaît notamment en Tite 2.6-8 :
« Encourage de même les jeunes gens à être pondérés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle de belles œuvres, avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, pour que l’adversaire soit confus et n’ait rien de mal à dire de nous. »
Évidemment, Paul savait que la perfection n’est pas de ce monde et que l’intégrité, c’est aussi d’être irréprochable dans le fait de se reconnaître soi-même pécheur. Mais le fait est que la crédibilité, et même la légitimité d’un prédicateur (et donc son autorité avec), peuvent voler en éclat à partir du moment où son intégrité est remise en question (quand un péché grave devient public, par exemple). C’est, nous le pensons avec raison, au vu de la responsabilité qui est la sienne en tant que héraut de la Parole.
2. En lien avec ce premier point, l’autorité du prédicateur sera également renforcée si lui-même vit ce qu’il prêche. Là encore, il n’est pas question de perfection : qui, en prêchant sur l’amour du prochain ou l’amour de l’ennemi par exemple, peut mettre parfaitement en pratique l’enseignement biblique sur le sujet ? Non, l’idée est davantage ici que le prédicateur est appelé à être soi-même le premier élève, le premier étudiant de ce qu’il prêche. Quand un prédicateur faisant autorité prêche sur l’amour de l’ennemi, il ne peut se positionner comme un spécialiste de l’amour de l’ennemi ou comme quelqu’un qui sait parfaitement comment faire. Par contre, il peut se présenter comme quelqu’un qui a fait le travail exégétique pour comprendre ce que Jésus enseigne, puis qui s’est laissé interpeller par cet enseignement. Fort de son étude, de sa méditation et de son introspection priantes, il saura alors exprimer combien cet enseignement est pour le moins difficile à mettre à pratique au vu de toutes les résistances internes qui l’animent, mais il saura également proposer des pistes concrètes de réflexion, de vécu. De ce fait, il pourra rejoindre l’assemblée qui expérimente ces mêmes résistances et a besoin de ses encouragements. L’autorité du prédicateur de la Parole s’exprime ainsi par l’œuvre que l’Esprit aura fait dans son cœur.
3. Comme évoqué plus haut, le fait que la Parole de Dieu fasse autorité doit encourager les prédicateurs à l’étudier en profondeur. Il semble aussi pertinent d’ajouter qu’une fois cette étude réalisée, le prédicateur exprime son autorité en croyant passionnément ce qu’il prêche.
Le pasteur théologien britannique John Stott relate dans un de ses livres sur la prédication une anecdote qui reflète combien la passion du prédicateur pour ce qu’il prêche peut et doit « transpirer », se voir et se ressentir. Il fait mention du grand prédicateur du réveil George Whitefield, dont la vie démontrait combien il plaçait sa confiance en Dieu et en sa Parole, la prêchant avec ferveur et courage. Même des non-croyants s’émerveillaient de la puissance qui se dégageait de ses prises de parole. Parmi eux, des personnages historiques tels Benjamin Franklin et David Hume. David Hume était pourtant plus que sceptique quant à la foi chrétienne, mais il suivait néanmoins ce grand prédicateur avec intérêt. Un jour, il voyagea plus de 30 km (nous sommes au 18e siècle) pour aller l’écouter prêcher. Là, une personne dans l’assemblée le reconnut et, sachant qu’il ne croyait pas un mot de ce que Whitefield disait, lui demanda la raison de sa présence. Hume répondit : « C’est vrai, mais lui le croit(6) ».
Prêcher avec passion, croire profondément et passionnément à ce qu’on prêche, cela vient mettre en relief l’autorité du prédicateur. Les auditeurs se sentent alors concernés, ils se disent que, si le prédicateur est si passionné, s’il croit autant à ce qu’il dit, c’est qu’il n’est pas en train de lire ou réciter le bottin. Il doit y avoir quelque chose à entendre et à retirer de son propos… Évidemment, rares sont les auditeurs qui se posent de façon consciente la question « Ce prédicateur croit-il vraiment à ce qu’il dit ? », mais ils peuvent clairement le ressentir, sans nécessairement pouvoir le formuler. Quand un prédicateur donne le sentiment qu’il espère seulement que ce qu’il dit est vrai ou pertinent, alors cela se voit. Ça « transpire » !
Dire ceci ne doit en rien remettre en question la nécessaire humilité du prédicateur qui, parfois, doit savoir admettre que son interprétation d’un texte biblique n’est qu’une hypothèse (la meilleure parmi d’autres, selon lui). En effet, même si le message biblique de salut est clair, certains textes sont plus difficiles à interpréter que d’autres, et l’un des grands enjeux de la formation biblique et théologique est justement d’apprendre à voir la complexité du texte biblique pour l’interpréter correctement. Il y a, ainsi, une ligne de crête sur laquelle marcher entre « croire passionnément ce que l’on prêche » et « l’exprimer avec humilité ». Admettre que tout n’est pas facile à comprendre – sans pour autant troubler l’auditoire en ne faisant que présenter toutes les options d’interprétation possibles sans jamais trancher – voilà ici encore, une manière pertinente d’exprimer son autorité en tant que prédicateur.
4. Il a été évoqué plus haut l’importance d’une exégèse sérieuse du texte prêché. Mais l’autorité du prédicateur ne s’exprime pas seulement par une exégèse bien relatée en prédication. Une autre exégèse est essentielle : celle de son assemblée. En effet, dans le travail de préparation, un prédicateur qui connaît l’assemblée pour laquelle il va prêcher, doit l’avoir en tête et ainsi anticiper les objections, les malentendus, les blocages, les besoins, etc., et éventuellement les mentionner dans la prédication. Alors, la communauté saura qu’elle a été prise en compte, que le prédicateur s’adresse vraiment à elle et que sa prédication n’est pas un simple copier-coller d’une prédication donnée ailleurs, pour d’autres.
Le risque est en fait assez conséquent : sans cette exégèse de la communauté pour laquelle il prêche, les gens comprendront rapidement que le prédicateur est un bon exégète du texte biblique, qu’il sait analyser le texte et le comprendre, mais qu’il vit néanmoins dans une tour d’ivoire, incapable de s’intéresser ou de rejoindre l’assemblée à qui il s’adresse pourtant.
C’est pourquoi il est si important d’offrir à l’assemblée des pistes d’applications(7) pour sa vie communautaire ou pour la vie des chrétiens individuels. Le prédicateur aura de l’autorité dans le sens que l’assemblée saura qu’il aura compris non seulement le texte prêché, mais aussi ce que ce texte signifie pour la vie de tous les jours des « vraies gens » auxquels il s’adresse.
5. Enfin – et cette caractéristique d’un prédicateur qui prêche avec autorité s’adresse peut-être davantage à de jeunes prédicateurs qu’à d’autres – il est essentiel d’être « soi-même » quand on prêche. C’est-à-dire : ne pas essayer d’imiter un autre prédicateur (ça ne marche pas) ; ne pas essayer de communiquer une image qui ne nous représente pas vraiment (on rejoint là la notion d’intégrité mentionnée plus haut). Le prédicateur aura de l’autorité à partir du moment où il prêchera avec sa propre voix parce qu’il n’est ni un perroquet ni un acteur. Ainsi, par exemple, un prédicateur émotif a le droit de pleurer si ce qu’il annonce ou explique le prend aux tripes ; et un prédicateur du genre flegmatique n’est pas obligé d’exprimer des émotions fortes qui ne lui ressemblent pas ou qu’il ne ressent pas (ça fera bizarre !).
Quoi qu’il en soit, souvenons-nous que c’est Dieu qui se sert de ce que nous apportons bien imparfaitement dans la prédication pour promouvoir la vie. Tout ne dépend pas des prédicateurs, heureusement ! Mais Dieu nous envoie, en tant que prédicateurs, pour annoncer, avec son autorité, ses hauts faits. Quel privilège ! Quelle responsabilité !