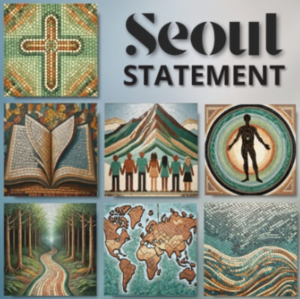 Au 4e congrès de Lausanne qui s’est déroulé à Incheon, près de Séoul, en septembre 2024, deux documents ont été associés, publiés l’un quelques semaines en amont (un rapport sur l’état d’avancement du mandat missionnaire), l’autre au tout début du congrès (le document intitulé en français la Proclamation de Séoul(1)).
Au 4e congrès de Lausanne qui s’est déroulé à Incheon, près de Séoul, en septembre 2024, deux documents ont été associés, publiés l’un quelques semaines en amont (un rapport sur l’état d’avancement du mandat missionnaire), l’autre au tout début du congrès (le document intitulé en français la Proclamation de Séoul(1)).
La Proclamation de Séoul n’est pas mise par le Mouvement de Lausanne sur le même plan que les textes des trois premiers congrès, à savoir la Déclaration de Lausanne, le Manifeste de Manille et l’Engagement du Cap. Il veut construire sur les fondements que ceux-ci ont posés tout en comblant certaines lacunes liées en particulier aux contextes contemporains.
Il est encore très tôt pour réagir à la Proclamation de Séoul ! Le recul manque et on peut même se demander si le texte actuellement disponible constitue la version définitive du document. Les commentaires « à chaud » risquent toujours de tomber à côté soit que l’on s’enthousiasme trop vite, soit que l’on s’irrite ou se désole de telle ou telle affirmation, ou de telle ou telle omission. Mais la « réception » de la Proclamation de Séoul dépendra aussi des réactions et des débats qu’elle suscitera ! Essayons d’en dire quelque chose en se concentrant sur le sujet de la responsabilité sociale du chrétien.
En effet, l’une des caractéristiques par lesquelles le Mouvement de Lausanne s’est fait connaître a été son souci social. La Déclaration de Lausanne de 1974 a fait date à cet égard, mais les documents suivants n’ont pas été en reste. Qu’en est-il de la Proclamation de Séoul ? On peut dire, en première approche, d’une part que le texte contient des mentions significatives des questions sociales et que, d’autre part, celles-ci ne sont pas regroupées dans une section générale qui leur accorderait un « focus » particulier et même que l’expression « mission intégrale » est employée d’une façon qui a semblé critique à beaucoup de lecteurs.
Il faut dépasser la première approche et commencer à creuser et discuter un peu. C’est ce que je propose de faire en tentant quelques réflexions nécessairement sommaires, peut-être parfois un peu provocantes, mais en tout cas toujours révisables, dans le but de mettre en relief quelques sujets à creuser.
Le rapport de la Proclamation de Séoul aux trois documents fondateurs
La présentation officielle de la Proclamation de Séoul précise explicitement que cette dernière n’est pas censée être lue toute seule, mais qu’elle complète et ne remplace pas les documents fondateurs : « […] elle ne cherche pas à être exhaustive ou à répéter des thèmes déjà mis en évidence dans ces documents(2) ». Il faut donc être prudent avant de donner une signification particulière à un silence sur un sujet déjà traité par le passé ou à des différences d’accentuations ou de perspectives. Par exemple, le fait que la Proclamation ne mentionne pas explicitement le changement climatique ou la situation des enfants en danger dont parlait l’Engagement du Cap ne permet pas de diagnostiquer une évolution du Mouvement de Lausanne sur ces thématiques. Allons plus loin : en théorie, la Proclamation de Séoul aurait très bien pu ne rien dire des questions sociales ou de la pauvreté sans que l’on soit en droit d’en tirer quelque conclusion que ce soit sur la position de Lausanne à leur égard.
En pratique cependant, les choses sont plus complexes. En effet, la Proclamation parle des sujets sociaux et il me semble qu’elle n’en parle pas de la même manière que les trois autres documents. L’approche est peut-être complémentaire, mais cela demande quand même à être vérifié. Nous ne pouvons pas purement et simplement prendre pour argent comptant les affirmations d’homogénéité du Mouvement de Lausanne d’abord parce que la « largeur encadrée(3) » de celui-ci rend peu vraisemblable que des textes écrits par des auteurs divers et à plusieurs années ou décennies de distance soient parfaitement « raccords », mais aussi parce que le corpus impressionnant des textes qu’il a produits ces cinquante dernières années comporte un peu plus que de simples différences de perspectives. L’homogénéité n’est déjà pas totale entre les documents fondateurs eux-mêmes.
Il faut surtout faire une différence entre les sujets abordés dans les différents textes et le modèle global pour les traiter. Evert Van de Poll relève qu’il est « frappant que [la Proclamation de Séoul] ignore des modèles bien connus comme la mission holistique, la mission intégrale, la missio Dei ou les cinq marques de la mission […](4) ». « Ignorer » est sans doute un verbe trop fort, mais le contraste est évident entre la Proclamation de Séoul et l’Engagement du Cap à cet égard : ce dernier document est façonné par l’approche de la Missio Dei. Que celle-ci n’apparaisse plus que très rarement(5) peut difficilement être expliqué par un raisonnement du type : nous avons déjà traité la Missio Dei antérieurement, il n’était pas nécessaire d’y revenir. En effet la Missio Dei est un concept englobant qui tend à prendre toute la place et à imprimer sa marque à tous les sujets et à le faire de plus en plus avec le temps.
Dans le cas du Mouvement de Lausanne, on peut observer l’évolution suivante : ...