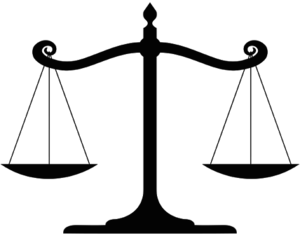 Introduction
Introduction
Au sein de l’Église, la protection de tous doit être au cœur des préoccupations, pour les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, les personnes les plus vulnérables et les plus vaillantes. L’Église, qu’elle soit vécue au sein des Églises locales ou des œuvres chrétiennes, se vit avant tout dans les relations humaines. Et qui dit relations humaines, dit aussi présence du péché et, par conséquent, risque de situations parfois dramatiques à gérer. Si la grâce en Christ surabonde, en tant qu’individus ou associations nous portons des responsabilités juridiques. Et nous pouvons favoriser l’œuvre de la justice humaine, source d’ordre et de restauration, à laquelle la Parole de Dieu nous invite à nous soumettre.
La présente note s’inscrit dans le contexte actuel, d’envergure mondiale, de révélation de crimes et délits au sein de l’Église catholique notamment. Ce contexte pousse le CNEF à s’interroger sur le fonctionnement des Églises et associations évangéliques en France et à initier un groupe de travail sur la déontologie professionnelle dans l’Église.
Par cette note, nous souhaitons rappeler les droits et les responsabilités de tous dans l’Église concernant la prévention des abus, des crimes et des délits, notamment contre les mineurs (cf. paragraphe I.A).
Il faut, d’une part, agir intentionnellement pour prévenir les situations problématiques (cf. paragraphe I.B) et, d’autre part, savoir agir avec sagesse en cas de détection de situations d’abus (cf. chapitre II), notamment en cas d’abus qui ne seraient conformes ni aux lois de la République ni aux principes et valeurs résultant de l’objet et de la mission que porte l’Église.
Nos Églises et nos œuvres, et toutes les personnes qui les animent ou en bénéficient, doivent être informées et sensibilisées quant aux obligations d’assistance à personne en péril (cf. paragraphe II.A) et aux obligations de dénonciation de crimes et délits avec leurs modalités d’application (cf. paragraphes II.B et II.C).
Les dirigeants des associations, les membres, les ministres du culte et les bénévoles : nul n’échappe à la loi. Certains portent même des responsabilités accrues en raison de leur fonction. Le règlement de certaines situations délicates « en interne », au sein de l’Église locale ou d’une association, ne saurait écarter les responsabilités pénales jusqu’à l’expiration des délais de prescription. Et il faut être conscient que si l’approche dite spirituelle, la fraternité et la grâce président (parfois trop) à l’examen des situations en interne, il n’en est pas question devant un tribunal.
Par ailleurs, le secret professionnel (cf. paragraphe II.C) qui peut s’appliquer en matière cultuelle est une exception à interpréter de manière restrictive. Il ne couvre que les informations confiées par les personnes dans le cadre de l’exercice de la mission cultuelle et non celles connues en dehors ou via des tiers. Et il ne saurait jamais justifier la non-assistance à personne en péril.
Enfin, dans un contexte de société propice à la médiatisation rapide via les réseaux sociaux, il est important de défendre aussi la vérité et de pouvoir se protéger contre de fausses accusations, des diffamations et des dénonciations calomnieuses (cf. paragraphe III.A).
Pour finir, nous soulignerons la question de la responsabilité des personnes morales (cf. paragraphe III.B). En effet, les associations elles-mêmes pourraient être sanctionnées, si elles ont laissé commettre des abus.
Quelques exemples font l’objet d’analyses juridiques synthétiques, par souci de sensibilisation.
I. Prévenir les situations d’abus dans l’Église
A. Respect des droits et libertés individuels par l’Église
Au sein de l’Église comme ailleurs, les individus, majeurs et mineurs, ont droit au respect de l’intégralité des droits et libertés résultant de la loi au sens large, de leur vie privée, de leur sûreté physique, de leur propriété privée, de leurs libertés d’opinion, d’expression, d’éducation et d’association ainsi que de leur liberté de circulation. Le libre arbitre de chacun doit être respecté.
Le contexte spirituel et communautaire de l’Église doit éviter toute violation des droits et libertés des individus. Il convient donc de mettre en œuvre les mesures adéquates afin que le contexte spirituel et communautaire de l’Église ne soit pas source de violation des droits et libertés des individus.
À cet égard, nous attirons l’attention sur deux violations de liberté (parmi d’autres) qui peuvent particulièrement concerner le cadre de l’exercice du culte ou d’activités spirituelles. Les auteurs pourraient être les ministres du culte, dirigeants ou membres des associations cultuelles.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »
- Toute contrainte concernant la liberté de culte, de faire partie d’une association cultuelle ou de contribuer aux frais d’un culte. Article 31 de la loi du 9 décembre 1905 :
« Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. »
.
B. Encadrement en amont des activités à risque
Prévenir les abus, c’est encadrer les activités à risque et anticiper les situations. S’agissant particulièrement des activités de jeunesse :
Pour les dirigeants associatifs, il s’agit de s’assurer que les mineurs sont encadrés par des personnes compétentes et au-dessus de tout soupçon. La responsabilité pénale des dirigeants associatifs pourrait être engagée s’ils avaient nommé un animateur jeunesse en dépit de leur connaissance de son profil ou de ses antécédents, judiciaires ou extra-judiciaires.
De bonnes pratiques permettent d’éviter les risques d’abus sur les mineurs :
-
Assurer la formation des animateurs et leur demander un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3 qui contient le cas échéant les mesures de suivi socio-judiciaire et peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs) et ce, au moment du recrutement et même s’ils sont bénévoles ;
- Présence de deux animateurs en continu : éviter qu’un animateur se retrouve seul avec un mineur ;
- Effectuer des contrôles spontanés réguliers lors des activités et mettre en place des processus d’évaluation afin de permettre aux responsables notamment d’exercer leur service en lien avec une personne en vis-à-vis ;
- Respecter strictement le droit à l’image des mineurs : il convient de limiter tout usage de l’image des mineurs sur les réseaux sociaux notamment et de n’utiliser leurs images que dans le cadre d’une autorisation expresse des détenteurs de l’autorité parentale et à des fins clairement explicitées.
De manière générale, il convient de :
- Connaître et faire connaître, avant toute prise d’activité, les obligations de chacun (cf. chapitre II. Agir en cas d’abus) ;
- Éviter toute situation de promiscuité ou d’intimité ;
Cela permet, en effet, une vigilance partagée par les membres de l’association en cas de dérives et la possibilité de rendre ses règles opposables aux contrevenants (membres de l’association, ministres du culte, bénévoles, etc.).
II. Agir en cas d’abus
Le droit pénal associe toute personne à la lutte contre le crime et le maintien de l’ordre public, en sanctionnant deux types d’infractions :
A. Le fait de s’abstenir d’empêcher un crime ou un délit, ou de venir en assistance à autrui ;
B. Le fait de s’abstenir de dénoncer des crimes ou des atteintes sur mineurs ou personnes en situation de faiblesse.
A contrario, il existe donc des obligations positives à contribuer à la prévention des infractions, notamment sur les mineurs. Ces deux obligations engagent ainsi les particuliers, mais également les personnes morales à agir positivement et légalement pour la protection de tous, en particulier des mineurs.
Lorsqu’une situation relevant du délit ou du crime est connue par une personne, que ce soit à l’occasion des activités de l’Église ou ailleurs, cette dernière est juridiquement responsable lorsqu’elle s’abstient d’une part, d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit et de porter assistance à personne en péril (cf. paragraphe II.A) et, d’autre part, de dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, crimes et maltraitance sur mineur ou personne en état de faiblesse (cf. paragraphe II.B), sauf à ce que la révélation soit contraire à ses obligations, au titre du secret professionnel (cf. paragraphe II.C).
A. Empêcher la commission d’un crime ou d’un délit et porter assistance à personne en péril
Article 223-6 du code pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
Toute personne est tenue d’agir pour empêcher la survenance d'un crime ou d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui ou pour porter assistance à autrui, dans la mesure où son action ne présente pas de risque pour elle ou des tiers. La responsabilité est aggravée lorsque le danger ou l’atteinte à l’intégrité corporelle concerne un mineur de quinze ans et moins. Cette obligation vaut sans exception, même pour les personnes astreintes au secret professionnel.
Ainsi une personne qui pourrait empêcher par exemple la commission d’un viol, d’un acte de violence physique ou sexuelle ou de mauvais traitements sur un adulte ou un mineur et n’agit pas personnellement ou ne sollicite pas le secours auprès de tiers, engage sa responsabilité pénale et civile.
Cela s’applique également au ministre du culte. Le secret professionnel ne crée pas d’exception à cette obligation de porter assistance ou d’empêcher la commission de crimes ou de délits par une action personnelle ou en provoquant le secours.
|
Exemple 1 :
Lors d’une réunion d’un groupe de jeunes, un membre de l’Église apprend qu’une jeune mineure a été violée par son oncle et risque de l’être à nouveau.
- Il a l’obligation de porter assistance à cette jeune fille pour empêcher la commission d’un nouveau viol. Il faut rapidement tenter de mettre cette jeune fille à l’abri et interpeller la famille afin d’assurer la sécurité de cette enfant.
- À défaut d’action de sa part, ce membre d’Église se rend coupable de non-assistance à personne en péril et s’expose à des poursuites pénales et civiles. À l’occasion d’un procès pour viol sur mineur, il pourra être reconnu coupable.
- Toutes les personnes ayant partagé la connaissance de cette situation (y compris les dirigeants associatifs et les ministres du culte) et s’étant abstenues d’empêcher la commission d’un nouveau viol pourraient également être reconnues coupables.
- De plus, elles ont l’obligation de dénoncer ce crime aux autorités judiciaires et administratives, sous réserve de l’application du secret professionnel (cf. paragraphe II.B. ci-après).
- La jeune fille et ses représentants légaux pourraient porter plainte contre ce membre de l’Église et les complices, pendant au maximum 18 ans à compter de la connaissance des faits.
|
B. Dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, crimes et maltraitance sur mineur ou personne en état de faiblesse
De plus, ce devoir de prévention des crimes et délits et d’assistance à personne en péril est complété par un devoir de dénonciation des crimes et délits, permettant à tout un chacun de contribuer à l’ordre public, d’éviter les récidives et de mettre à l’abri les victimes. Ces obligations de dénonciation ressortent des articles 434-1 à 434-3 du code pénal. En sont exemptées les personnes astreintes au secret professionnel, qui disposent ainsi d’une option de conscience (cf. paragraphe II.C).
-
Dénoncer pour prévenir ou limiter les effets d’un crime ou la commission de nouveaux crimes.
Article 434-1 du code pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
-
Dénoncer les privations, les mauvais traitements ou les agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne en état de faiblesse.
Article 434-3 du code pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Il s’agit ainsi de dénoncer des faits et non des personnes : crimes consommés et tentatives de crimes, pour empêcher ou éviter la commission de nouveaux crimes ou pour protéger des mineurs de moins de quinze ans ou des personnes en état de faiblesse contre de mauvais traitements, sévices, violences... La jurisprudence rappelle que la dénonciation de l'existence du crime est requise et non une délation de son auteur et de son complice.
La dénonciation s’effectue auprès d’autorités légalement désignées : les autorités judiciaires et administratives (le ministère public, le préfet, le maire, les forces de police et de gendarmerie, et également les personnes qui interviennent pour leur compte...). Dénoncer auprès de sa hiérarchie interne ne suffit pas : un règlement des situations visées en interne par la voie disciplinaire ne remplit pas les conditions légales de l’obligation de dénonciation(1). L’infraction sera constituée par l’absence de dénonciation volontaire aux autorités judiciaires ou administratives. L'intention sera déduite de la connaissance du crime, les mobiles étant indifférents.
S’agissant du degré de connaissance de l'existence du crime, l'incrimination de non-dénonciation de crime est d'interprétation stricte et devrait être maintenue dans ses exactes limites (Cass. crim., 17 avril 1956 : Bull. crim., n° 311). Ainsi la connaissance directe du crime, par exemple par un témoin direct du crime ou par information directe de la victime, oblige à dénoncer. De simples rumeurs ou des informations vagues et indirectes n’y obligeraient pas. Ce point est à mettre en parallèle avec le délit de dénonciation calomnieuse (cf. paragraphe III.A.).
La complicité de l'infraction de non-dénonciation de crime est punissable : une personne qui inciterait le témoin d’un crime, ou une personne directement informée d’un crime à ne pas dénoncer, se rendrait coupable de complicité du délit de non-dénonciation.
Il serait possible de retenir cumulativement les qualifications de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime(2).
En matière de prescription, nous attirons l’attention sur le délai de prescription des délits de non-dénonciation.
-
Premièrement, le délai a subi un allongement suite à la réforme de la prescription pénale
(3) passant de 3 à 6 ans.
- Deuxièmement, s’agissant de la détermination de son point de départ, il faut conjuguer deux éléments : la connaissance du crime et l’absence de dénonciation. Puisque l’obligation de dénonciation a pour but de permettre la connaissance et la poursuite des crimes et des mauvais traitements, on peut considérer qu’elle dure tant que précisément les faits n’ont pas été dénoncés et ne sont donc pas connus, et pas seulement le jour où l’on a connaissance des crimes ou des mauvais traitements. Le délit de non-dénonciation de crime est une infraction instantanée, commise au moment où la dénonciation est requise. La dénonciation est requise du fait de la connaissance du crime et de l’absence de dénonciation. Si le crime se répète, la dénonciation reste requise pour ce nouveau crime. Dans le cas de maltraitance envers un mineur ou une personne vulnérable, la dénonciation est requise tant que la maltraitance dure, le délai de prescription débutant dès lors que les infractions ont pris fin. Dans les deux cas, l’infraction de non-dénonciation est donc commise au moment où la dénonciation est requise.
-
Troisièmement, le délai de prescription pourrait être sujet à suspension. En effet, la loi du 27 février 2017 a généralisé la suspension de la prescription pour les infractions occultes et dissimulées, dans la limite de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. Cette cause de suspension permettra sans doute d’allonger la prescription de l’infraction de non-dénonciation de mauvais traitement et de crime pour une durée maximale de 18 ans.
L’action publique est exercée devant les juridictions répressives dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du code de procédure pénale et la victime est en droit de demander réparation du dommage causé par l'infraction par une action civile. L'action publique peut être déclenchée par le ministère public, ou par la victime de cette infraction (ou ses représentants, comme les parents du mineur).
Les sanctions pénales sont des peines de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende en cas de non-dénonciation de crime ou de maltraitance ; 5 ans et 75.000 euros dans le cas de non-dénonciation de maltraitance sur mineurs de moins de quinze ans et cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende lorsque le crime visé constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme prévu. Dans le cas du délit de non-dénonciation de maltraitance, la peine de sanction-réparation peut être prononcée à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, selon les modalités fixées à l'article 131-8-1 du code pénal. Concernant l’évaluation du préjudice sur le plan civil, seul le préjudice résultant directement de l'infraction de non-dénonciation peut être réparé et non le dommage causé par le crime commis ou tenté ou la maltraitance subie. Le montant varie en fonction des circonstances de l’espèce.
Pour rappel, la jurisprudence récente illustre des cas de condamnation pour non-dénonciation dans le domaine religieux :
-
Le cardinal Philippe Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon (Rhône) le 7 mars 2019. Il était poursuivi pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commises dans les années 1970 et 1980 en banlieue lyonnaise par l’ancien aumônier scout, le père Bernard Preynat. Il lui était reproché de ne pas avoir alerté la justice alors qu’il était au courant du passé pédophile du prêtre déviant. Il a été « déclaré coupable de non-dénonciation de mauvais traitements » envers un mineur entre 2014 et 2015. Il a fait appel de sa condamnation.
- En novembre 2018, l’ancien évêque d’Orléans, André Fort, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs commises par le prêtre Pierre de Castelet, sous sa hiérarchie. Le prêtre a été condamné à trois ans de prison dont un avec sursis pour agressions sexuelles sur mineurs.
-
Mgr Pierre Pican, ancien évêque de Bayeux-Lisieux, a été condamné en 2001 à trois mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé un prêtre coupable d'abus sexuels sur mineurs, l'abbé René Bissey qui, lui, avait été condamné à dix-huit ans de prison un an plus tôt.
C. Utiliser l’option de conscience à bon escient, lorsque les informations sont couvertes par le secret professionnel
Article 226-13 du code pénal :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
Article 226-14 du code pénal :
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être (CRIP), mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. »
Le secret professionnel, notamment dans le domaine religieux, reste un élément indispensable de la relation de confiance entre le « professionnel » et la personne qui se confie. La loi protège le respect du secret professionnel par de lourdes sanctions pénales en cas de révélation. D’une manière générale, les bienfaits et avantages du secret doivent être reconnus et préservés au nom de la liberté de conscience, de pensée et de religion. La loi permet une option de conscience dans des cas précis où le secret serait trop lourd à porter pour le professionnel ou contraire à la protection des plus faibles.
Ainsi faut-il user du secret professionnel et de l’option de conscience dont il est assorti avec discernement pour favoriser la protection des plus faibles tout en résistant parfois à la pression d’une « transparence » à tout prix, prétendument protectrice des libertés.
Le secret professionnel demeure donc une notion à manier avec beaucoup de prudence. Dans le cas de la connaissance de faits couverts par les obligations de dénonciation décrites ci-dessus (crimes, délits, mauvais traitements ou agressions sexuelles sur mineurs...), une option de conscience est ouverte : garder le secret est possible, dénoncer est possible. Aucune option ne sera sanctionnée pénalement.
Dans le cadre de l’Église, le secret professionnel couvrira non seulement le ministre du culte mais également tout officiant assimilable à un ministre du culte ainsi que toute personne assurant une mission religieuse, tels les diacres et les coopérateurs de mission pastorale. Cela vaut également pour les collaborateurs recevant des informations confidentielles, telles les épouses de pasteur, ou les membres d'un conseil d'Église ou les anciens. Le cercle des personnes susceptibles d'être concernées par le secret professionnel est bien plus vaste que le seul ministre du culte. Il en va de même pour toute personne qui occupe dans les faits, à la réception des informations, une fonction de ministre du culte.
Néanmoins, le champ d’application du secret est extrêmement réduit et lié à chaque cas d’espèce, notamment au cadre de la connaissance des faits, alors que celui de l’obligation de dénoncer est général : la connaissance des faits implique l’obligation de dénoncer.
Ainsi, faut-il retenir que, pour tout un chacun, le principe général demeure l’obligation de dénoncer alors que, pour les ministres du culte par fonction ou par état, qui ont eu connaissance des faits par confidence, le principe demeure l’obligation au secret, sauf dans les cas où l’option de conscience est ouverte.
Aussi, avant de se retrancher derrière le secret professionnel pour s’abstenir de dénoncer, il conviendra de vérifier très précisément que les conditions d’application du secret sont réunies(4). Nous attirons l’attention sur plusieurs points à cet égard :
- Le cadre factuel de la connaissance des informations détermine si le secret s’applique ou non. Ainsi lorsque les informations ont été reçues hors champ du ministère cultuel, le secret ne s'applique pas alors que, parallèlement, l’obligation de dénonciation s’applique sans exception. C’est le cas lorsque les informations ont été reçues, par exemple, exclusivement en tant qu'ami, parent, médiateur ou supérieur hiérarchique comme l'illustre la jurisprudence ou de manière indirecte, par exemple par voie d’enquête, et non dans le cadre de la confidence, de manière volontaire et directe de la part de la personne concernée.
Ainsi, dans le cas d'un évêque à qui un prêtre de son diocèse avait avoué avoir commis plusieurs viols sur des mineurs, le secret professionnel n'avait pas été retenu, parce que cette révélation n'avait pas eu lieu dans le cadre étroit du secret de la confession, et, partant de ce constat, l'évêque qui avait gardé le silence sur ces faits a pu être condamné pour non-dénonciation de crime(5).
Un arrêt a rejeté l'argument tiré du secret professionnel des ministres du culte à l'égard des membres du Conseil des anciens des Témoins de Jéhovah qui avaient convoqué un des membres pour lui reprocher des faits de mauvais traitements sur mineur et l'exclure, les juges précisant que le secret de la confession suppose une circulation spontanée de l'information de l'auteur des faits vers un professionnel(6).
En septembre 2001, l’évêque de Bayeux a été condamné par le tribunal correctionnel à trois mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crimes pédophiles dans son diocèse(7). L’évêque avait eu connaissance des faits commis par un prêtre suite à des plaintes de familles et avait diligenté une enquête interne à cet effet. Il n’avait pas dénoncé les faits et s’était contenté d’encourager le prêtre à se faire soigner.
- Dans ce domaine, la sécurité juridique demeure limitée. Il sera extrêmement délicat de préjuger de l’issue d’une affaire dans laquelle une personne aura préféré le secret à la dénonciation de crime ou de maltraitance. Les cas d’espèce révèlent des situations très variées.C’est donc à l’appréciation souveraine des juges du fond qu’il faudra se fier.
- La politique pénale est stricte sur le sujet. La circulaire du Ministère de la Justice de 2004 sur le secret professionnel des ministres du culte, qui nous semble toujours d’actualité, dispose :
« C'est pourquoi vous veillerez à ce que les procureurs de la République fassent diligenter de manière systématique des enquêtes dès lors qu'existe une suspicion de non-révélation de crime ou de mauvais traitements ou de privations infligés à des mineurs de moins de quinze ans ou à une personne vulnérable, afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel cadre le représentant du culte concerné a eu connaissance des faits. »
-
L’option de conscience est ouverte dans les cas de dénonciation prévus aux articles 434-1 et 434-3 du code pénal. L’article 226-14 du code pénal établit plusieurs autres cas dans lesquels la révélation du secret ne sera pas sanctionnée si l’intéressé révèle aux autorités désignées une information concernant des privations ou sévices sur mineurs ou personnes vulnérables, notamment de nature sexuelle.
|
Exemple 2 :
La femme du pasteur s’aperçoit lors d’un après-midi entre mamans de l’Église, qu’un enfant de trois ans est couvert de bleus et semble mal nourri. Les mois passent et l’état de l’enfant se dégrade. La famille ne vient plus à l’Église. La femme du pasteur continue de visiter cette famille régulièrement mais elle hésite à faire un signalement à Allô Enfance en Danger par peur de blesser la maman. Elle partage l’information avec son mari qui l’incite à ne pas dénoncer et à ne pas agir pour ne pas faire de vagues.
À quatre ans, l’enfant décède sous les coups de ses parents. Une enquête est ouverte. Le Ministère public porte plainte contre le couple pastoral qui côtoyait cette famille, pour non-assistance à personne en péril et non-dénonciation de maltraitance sur mineurs.
Dans ce cas, la femme du pasteur aurait d’abord dû agir pour porter secours à l’enfant : elle risque une condamnation pénale pour non-assistance à personne en péril. Son mari, qui a eu connaissance des faits, risque les mêmes peines à cet égard.
Ayant eu connaissance des faits à l’occasion de visites ou de rencontres dans le cadre de l’Église et ainsi du ministère pastoral, la femme du pasteur souhaite se retrancher derrière le secret professionnel pour se dégager de l’obligation de dénoncer des mauvais traitements sur mineurs de moins de quinze ans. Le cas pourrait relever de l’article 226-14 du code pénal concernant les privations et sévices sur mineurs. Ainsi le secret serait inapplicable.
Quant au pasteur, les confidences de sa femme ne sont pas couvertes par le secret professionnel et le secret partagé se plaidera difficilement. Ce dernier n’avait certes pas une connaissance directe des faits, mais détenait toutefois une connaissance suffisamment fiable pour alerter, par exemple les services administratifs de la protection de l’enfance.
Ce couple pourra difficilement plaider l’application du secret professionnel du ministre du culte dans ce cas grave. Il sera de toute manière condamnable pour non-assistance à personne en péril. Toutefois la condamnation dépendra de l’appréciation souveraine des juges et des circonstances de fait.
|
III. Deux autres points de vigilance
A. Se protéger des fausses accusations : diffamation et dénonciation calomnieuse
S’agissant d’accusations, il convient de distinguer, d’une part les faits de diffamation (publique ou non publique) qui peuvent être généraux, notamment sur les réseaux sociaux (par exemple #balancetonporc), des faits de dénonciation calomnieuse qui portent précisément sur les dénonciations aux autorités en vue d’une sanction pénale (quelqu’un porte plainte légèrement ou pour des faits qui se n’avèrent pas constituer une infraction pénale). Dans les deux cas, les personnes qui s’estimeraient faussement accusées peuvent se défendre en justice.
Il est important de ne pas prendre à la légère le fait d’accuser quelqu’un, de le dénoncer ou de porter plainte.
La diffamation est définie dans la loi du 29 juillet 1881 ainsi :
« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »
Selon l’article 226-10 du code pénal :
« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende... »
B. Responsabilité des associations en tant que personnes morales ?
Les associations pourraient-elles être tenues responsables des abus commis en leur sein ou au cours de leurs activités, voire par leurs salariés ou ministres du culte ?
La responsabilité pénale des personnes morales existe et peut être actionnée en cas d’infractions, commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants, selon l’article 121-2 du code pénal. Elles peuvent être responsables de plein droit de l’ensemble des infractions sauf si le législateur exclut expressément cette responsabilité(8).
Ainsi, une personne morale peut se voir reprocher une infraction consommée ou une infraction tentée, elle peut également être auteur ou complice, soit par aide ou assistance, soit par provocation.
S’agissant des infractions de non-assistance à personne en péril ou de non-dénonciation de crimes ou maltraitance sur mineurs ou personnes vulnérables, si les agissements délictueux relevaient des organes de l’association (connaissance des faits et décision partagée en conseil d’administration ou en bureau de ne pas agir ou de ne pas dénoncer pour protéger la réputation de l’association, par exemple), l’association pourrait voir sa responsabilité pénale engagée.
Selon les circonstances de l’espèce, une association cultuelle ou culturelle pourrait donc être sanctionnée pénalement, les sanctions allant des peines d’amendes (jusqu’à cinq fois les montants prévus pour les personnes physiques) à la dissolution judiciaire de l’association.
Par ailleurs, la présomption d'innocence et le respect de la vie privée des personnes devront être pris en compte dans le cadre de la communication interne ou externe des associations, mais également dans les cas d'exercice de la discipline spirituelle dans l’Église ou dans le cadre de l'application des statuts et règlement intérieur des associations lorsque des mesures (par exemple de suspension, d'exclusion, de perte de responsabilité...) sont susceptibles d'être prises à l'encontre des membres de l’association.